-
Par Anne-yes le 2 Février 2024 à 18:27
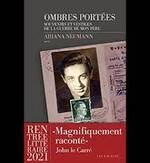 Souvenirs et vestiges de la guerre de mon père
Souvenirs et vestiges de la guerre de mon pèreNée en 1970, Ariana Neumann est une journaliste d‘origine vénézuélienne installée en Grande-Bretagne. Son père, Hans Neumann (1921-2001), était un Juif de Tchécoslovaquie, d’une famille non croyante (lui et son frère Lotar ne sont pas circoncis). Il est un des rares membres de sa famille à survivre à la shoah. Il émigre au Venezuela après la guerre. A sa fille il n’a jamais parlé de son passé ni de sa famille, elle sait à peine qu’il est Juif. Quand son père meurt, Ariana Neumann hérite d’une boîte contenant divers documents, souvenirs de la jeunesse de Hans à Prague et de sa vie pendant la guerre. Quelques années plus tard, après avoir récupéré auprès d’une cousine un album photos de la famille Neumann, l’autrice se met en quête de l’histoire de sa famille paternelle. Elle fait traduire les lettres, s’adjoint le concours d’une historienne de la shoah, reconstitue son arbre généalogique et prend contact avec des cousins ignorés jusqu’alors. Elle raconte dans ce passionnant récit tout ce qu’elle a découvert.
Je suis stupéfaite par la richesse du matériau historique sur lequel elle a mis la main et qui semblait n’attendre que sa venue pour être rassemblé. Il y a là de quoi rendre envieux bien des historiens, il me semble. Richard et Victor Neumann, les frères d’Otto, le grand-père paternel de l’autrice, avaient émigré aux Etats-Unis avant la guerre. Ariana Neumann entre en contact avec les petits-fils de Victor et l’un d’eux lui confie une collection de lettres envoyées depuis la Tchécoslovaquie après son invasion par l’Allemagne nazie, quand Otto et sa famille espéraient pouvoir quitter leur pays.
Ariana Neumann échange des courriers avec le propriétaire actuel de la résidence de campagne de ses grands-parents paternels en banlieue de Prague et celui-ci lui envoie des documents familiaux trouvés dans le coffre-fort de la maison.
J’ai trouvé intéressant d’avoir lu ce livre après Vivre avec une étoile car je retrouve les mêmes informations dans ce récit que dans le roman de Jiří Weil. Comme Roubiček la famille Neumann est victime d’interdictions de plus en plus nombreuses et menacée de déportation vers le ghetto de Terezín. Otto et sa femme Ella y sont envoyés. Convoqué à plusieurs reprises, Hans quant à lui retarde l’échéance en se faisant déclarer comme travailleur indispensable. Quand cela n’est plus possible il se cache d’abord à Prague puis gagne Berlin où, sous une fausse identité, il se fait engager comme technicien dans une usine qui travaille pour l’armée allemande. Ariana Neumann a retrouvé les preuves de ces péripéties dans la boîte que son père lui a léguée.
Son enquête est aussi pour l’autrice l’occasion de découvrir qui était son père. Elle a connu l’homme déjà âgé, industriel prospère d’une ponctualité tatillonne, muet sur son passé et un peu intimidant de par sa rigueur. Elle découvre qu’il fut un adolescent facétieux et blagueur, maladroit et toujours en retard. Entre les deux le traumatisme dû à la peur constante d’être pris, la mort des parents à Auschwitz, le complexe du survivant et l’impossibilité d’avoir pu prouver à son père qu’il était capable de se comporter de façon responsable.
J’ai beaucoup apprécié cette lecture.
Bien que ce récit soit écrit en anglais il compte pour le Mois latino organisé par Ingannmic.
 11 commentaires
11 commentaires
-
Par Anne-yes le 30 Janvier 2024 à 10:00
 A Prague, sous l’occupation nazie, le narrateur, Josef Roubiček, Juif, ancien employé de banque, survit dans une mansarde en attendant la déportation. Il a brûlé tout ses meubles pour se chauffer et pour qu’Ils (l’occupant n’est jamais nommé) n’aient rien à lui prendre. Un acte de résistance à la mesure de ce doux. Seul, sans famille, sans amis, souffrant du froid et de la faim, soumis à des humiliations et à des interdictions toujours plus nombreuses il tient le coup en se réfugiant dans les rêves et les souvenirs de sa vie passée, particulièrement celui de Růžena, une femme mariée avec qui il eut une liaison. Malgré l’interdiction de posséder des animaux domestiques il se lie aussi d’amitié avec Thomas, un chat errant qu’il accueille dans sa chambre. Mais un jour, alors qu’il prend le soleil dans un terrain vague, Roubiček fait la connaissance de Materna, un ouvrier qui l’invite chez lui.
A Prague, sous l’occupation nazie, le narrateur, Josef Roubiček, Juif, ancien employé de banque, survit dans une mansarde en attendant la déportation. Il a brûlé tout ses meubles pour se chauffer et pour qu’Ils (l’occupant n’est jamais nommé) n’aient rien à lui prendre. Un acte de résistance à la mesure de ce doux. Seul, sans famille, sans amis, souffrant du froid et de la faim, soumis à des humiliations et à des interdictions toujours plus nombreuses il tient le coup en se réfugiant dans les rêves et les souvenirs de sa vie passée, particulièrement celui de Růžena, une femme mariée avec qui il eut une liaison. Malgré l’interdiction de posséder des animaux domestiques il se lie aussi d’amitié avec Thomas, un chat errant qu’il accueille dans sa chambre. Mais un jour, alors qu’il prend le soleil dans un terrain vague, Roubiček fait la connaissance de Materna, un ouvrier qui l’invite chez lui.J’ai trouvé excellent ce roman, fort bien écrit, qui fait bien ressentir comment l’accumulation successive d’interdictions parfois contradictoires, sans signification, englue petit à petit les victimes et les amène à considérer la déportation comme une solution de facilité. Jiří Weil montre aussi les événements qui rattachent Roubiček et l’amènent à envisager la possibilité de s’en sortir : un inconnu croisé dans la rue qui lui suggère d’enlever son étoile pour pouvoir prendre le tram, un miracle qui lui permet d’échapper à une rafle, un morceau de musique écouté dans un sanatorium.
Keisha, Ingannmic et Passage à l’Est! proposent aussi des lectures à l’occasion du 27 janvier, journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la shoah.
 14 commentaires
14 commentaires
-
Par Anne-yes le 27 Janvier 2024 à 10:00
 En 2006 le succès éditorial et critique des Bienveillantes de Jonathan Littell a mis en colère Charlotte Lacoste. Elle s’en explique dans cet essai très documenté paru en 2010. Le héros des Bienveillantes, le SS Max Aue, nous est présenté comme un homme cultivé et intelligent. A propos de ses crimes lui-même apostrophe, dès les premières pages, le lecteur : « ce que j’ai fait, vous l’auriez fait aussi ». L’autrice déplore grandement que, pour comprendre ce qui a causé les génocides et crimes de guerre du 20° siècle, le personnage du bourreau ait aujourd’hui plus de succès en littérature que les témoins d’autant plus quand il se fait passer lui-même pour un témoin, voire une victime.
En 2006 le succès éditorial et critique des Bienveillantes de Jonathan Littell a mis en colère Charlotte Lacoste. Elle s’en explique dans cet essai très documenté paru en 2010. Le héros des Bienveillantes, le SS Max Aue, nous est présenté comme un homme cultivé et intelligent. A propos de ses crimes lui-même apostrophe, dès les premières pages, le lecteur : « ce que j’ai fait, vous l’auriez fait aussi ». L’autrice déplore grandement que, pour comprendre ce qui a causé les génocides et crimes de guerre du 20° siècle, le personnage du bourreau ait aujourd’hui plus de succès en littérature que les témoins d’autant plus quand il se fait passer lui-même pour un témoin, voire une victime.La première partie de l’ouvrage est consacrée à la notion de témoignage. Charlotte Lacoste s’appuie sur le travail de Jean Norton Cru (1879-1949) pour montrer pourquoi un roman peut paraître plus réaliste qu’un témoignage. Jean Norton Cru a combattu dans les tranchées pendant la première guerre mondiale. Avant même qu’elle ne se termine il constate que des récits qu’il lit dans la presse ou dans des romans et qui sont présentés comme des témoignages de soldats ne correspondent pas à la réalité. Dans Témoins, paru à compte d’auteur en 1929, il analyse 304 titres qu’il classe en fonction de leur valeur documentaire.
Charlotte Lacoste elle-même décortique quelques titres de la seconde moitié du 20° siècle qui donnent la parole à des bourreaux et qui concernent trois épisodes de crimes de guerre et meurtres de masse : la shoah, la torture durant la guerre d’Algérie et le génocide des Tutsi par les Hutu au Rwanda. Ces textes sont de trois natures : « témoignages » de bourreaux (tortionnaire en Algérie), ouvrages se présentant comme des témoignages mais étant en fait fortement romancés et romans (Les Bienveillantes mais aussi La mort est mon métier pour ceux que j’ai lus). Charlotte Lacoste qualifie ces ouvrages de négationnistes en ce sens que, développant la thèse que l’homme est un loup pour l’homme et assurant que n’importe qui à la place du bourreau aurait fait la même chose, ils insinuent -ou même disent clairement- que les rôles auraient pu être inversés, voire que ce sont les victimes qui sont responsables de leur sort. Par ailleurs, à se concentrer sur des individus on oublie les causes politiques du Mal : les génocides sont planifiés et organisés à l’avance au sommet de l’État.
Enfin, à partir d’Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt, Charlotte Lacoste nous explique que la notion de banalité du mal développée par la philosophe a été mal comprise. Il ne s’agissait pas de dire que Eichmann était un homme banal, ordinaire, mais que faire le mal était pour lui quelque chose de banal.
Professeure de littérature, Charlotte Lacoste a un autre bagage littéraire que moi, ses analyses de textes sont approfondies et elle repère des influences -notamment mythologiques- où je n’avais rien remarqué. Je n’ai donc absolument pas lu Les Bienveillantes comme elle. Je n’ai pas eu le sentiment que Jonathan Littell tentait de me faire prendre Max Aue pour une victime ou un homme ordinaire. J’ai au contraire pensé que ce dernier était sacrément perturbé. Aussi je n’ai pas toujours apprécié le ton de Charlotte Lacoste que j’ai trouvé condescendant à l’encontre des lecteurs qui ont apprécié Les Bienveillantes. J’ai bien compris qu’elle était en colère mais je ne suis pas sûre qu’en faisant sentir aux gens qu’ils sont des imbéciles ont leur donne envie de s’intéresser à ses arguments. Il me semble que ce qui a manqué dans cet essai c’est un regard plus nuancé sur le lectorat.
Petit à petit cependant, Charlotte Lacoste amène des arguments qui m’ont donné à penser. C’est une lecture qui m’a fait réfléchir et je serai sans doute plus attentive à l’avenir quand je lirai un livre dont le personnage principal est un bourreau. Cette lecture m’a aussi donné envie de lire Eichmann à Jérusalem et de relire Si c’est un homme.
Le 27 janvier est la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la shoah. J'ai gardé ce compte rendu pour les lectures autour de la shoah qui avaient lieu du 27 janvier au 3 février et je découvre au moment de le mettre en ligne que ce rendez-vous que j'appréciais et qui était organisé par Et si on bouquinait un peu et Passage à l'Est! n'existe plus. J'en suis navrée.
 6 commentaires
6 commentaires
-
Par Anne-yes le 19 Janvier 2024 à 16:09
L’écrivain polonais Paweł Huelle est mort le 27 novembre 2023 à Gdansk, ville où il était né en 1957. Il a d’abord travaillé au service de presse de Solidarność puis a été journaliste. Il était très attaché à sa ville de Gdansk qui sert de décor à pratiquement tout ses romans.
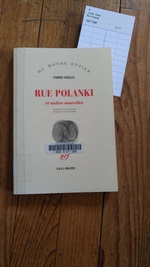 Rue Polanki et autres nouvelles. Les huit nouvelles rassemblées dans ce recueil ont toutes la ville de Gdansk pour cadre. Elle nous est décrite comme une ville où la nature est très présente avec la proximité de la forêt, les îles et berges de la Motlawa et des friches urbaines, ruines de greniers à blé rendues à la végétation ou jardins abandonnés des villas du quartier allemand. Je trouve la description qui est faite de ces paysages urbains très plaisante. Dans toutes ces nouvelles (sauf Pluie d’argent) un narrateur se remémore un épisode de son enfance ou de sa jeunesse. Je soupçonne que certains sont en partie autobiographiques.
Rue Polanki et autres nouvelles. Les huit nouvelles rassemblées dans ce recueil ont toutes la ville de Gdansk pour cadre. Elle nous est décrite comme une ville où la nature est très présente avec la proximité de la forêt, les îles et berges de la Motlawa et des friches urbaines, ruines de greniers à blé rendues à la végétation ou jardins abandonnés des villas du quartier allemand. Je trouve la description qui est faite de ces paysages urbains très plaisante. Dans toutes ces nouvelles (sauf Pluie d’argent) un narrateur se remémore un épisode de son enfance ou de sa jeunesse. Je soupçonne que certains sont en partie autobiographiques.Dans Rue Polanki le narrateur est invité à la réception organisée à l’occasion des 50 ans du président Walesa dans la maison de ce dernier, située rue Polanki. Cette invitation l’amène à se souvenir d’épisodes de sa vie ou même de celle de son grand-père qui se sont déroulés dans cette rue. Les aller-retour entre le passé du narrateur et 1995, présent de la réception, racontent aussi une histoire des luttes pour l’indépendance de la Pologne.
Grâce à cette lecture j’ai découvert les grands traits de l’histoire de Gdansk au 20° siècle. Après la Première guerre mondiale elle a le statut de ville libre sous le contrôle de la SDN. Sa population est majoritairement allemande. Dans les années 1930 les croix gammées sont de plus en plus nombreuses dans la ville qui est occupée par l’Allemagne en 1939. A la fin de la Seconde guerre mondiale c’est l’URSS qui occupe Gdansk, les Allemands s’exilent, leurs belles demeures tombent en décrépitude, des habitants sont déportés au goulag :
« Lucjan voulait devenir étudiant à l’Institut d’Orient, Ida envisageait d’étudier la sculpture. Le destin avait exaucé ces rêves. Au camp, tout en sciant du bois, Lucjan avait appris le kirghize, le turkmène, le persan et la langue de l’Altaï, dans une carrière au-delà de l’Oural Ida avait taillé les plus beaux blocs. » (Gute Luisa)
Cela m’a donné envie d’en savoir plus sur l’histoire de cette ville et même de la visiter. J’ai aimé la belle écriture aux piques caustiques, l’ambiance tantôt nostalgique tantôt onirique, les personnages sympathiques liés par l’attachement à leur ville quelque soit leur origine.
Un livre acheté chez un bouquiniste en ligne. Il vient de la bibliothèque départementale du Pas-de-Calais à Arras, il a coûté 120 F et il a encore dans sa jaquette sa petite fiche cartonnée qui nous révèle qu'il n'a pas été souvent emprunté...
Avec cette lecture je participe au défi Bonnes nouvelles organisé par Je lis, je blogue.
 3 commentaires
3 commentaires
-
Par Anne-yes le 13 Janvier 2024 à 18:13
 Dans ce quatrième épisode de La saga des Cazalet nous retrouvons cette grande famille après la guerre, entre après une longue absence l’été 1945 et 1947. C’est une période de changement pour beaucoup : Hugh est veuf, Edward divorce et Rupert, revenu de France, doit réapprendre à vivre avec sa femme -et inversement. Leurs enfants les plus âgés sont mariés ou en passe de l’être. La société aussi a changé. Les jeunes filles et même certaines femmes de la génération précédente (Viola, Zoë) ne se satisfont plus de rester au foyer et cherchent un emploi. C’est de plus en plus difficile de trouver des domestiques car les jeunes campagnards peuvent trouver en ville des métiers mieux rémunérés. Le cadre est celui d‘une Angleterre encore touchée par les pénuries et soumise au rationnement.
Dans ce quatrième épisode de La saga des Cazalet nous retrouvons cette grande famille après la guerre, entre après une longue absence l’été 1945 et 1947. C’est une période de changement pour beaucoup : Hugh est veuf, Edward divorce et Rupert, revenu de France, doit réapprendre à vivre avec sa femme -et inversement. Leurs enfants les plus âgés sont mariés ou en passe de l’être. La société aussi a changé. Les jeunes filles et même certaines femmes de la génération précédente (Viola, Zoë) ne se satisfont plus de rester au foyer et cherchent un emploi. C’est de plus en plus difficile de trouver des domestiques car les jeunes campagnards peuvent trouver en ville des métiers mieux rémunérés. Le cadre est celui d‘une Angleterre encore touchée par les pénuries et soumise au rationnement.J’ai beaucoup aimé cette lecture que j’ai trouvée très plaisante d’autant plus que, sur la durée, je me suis attachée aux personnages. Je trouve le dernier chapitre plus faible cependant, où l’on voit Archie, le confident de la famille Cazalet, se remémorer toutes les étapes de sa relation avec Polly, étapes qui nous avaient déjà été présentées par les yeux d’autres personnages. Ca fait un peu redite. Et tout ça pour en arriver à un énième mariage entre une femme et un homme nettement plus âgé qu’elle (15 à 20 ans) ! Dans le seul cas inverse, où on a un mariage entre un jeune homme et une femme plus âgée, c’est une menteuse (elle a menti sur son âge) et une femme insatiable qui dilapide l’argent du ménage et épuise son jeune mari au lit. Je n’apprécie pas trop non plus qu’on essaie de nous faire passer Edward, père incestueux et mari infidèle, pour quelqu’un de sympathique, voire même qui serait à plaindre. Si je mets de côté mes sentiments féministes tout va bien et je passe un bon moment.
 8 commentaires
8 commentaires
-
Par Anne-yes le 8 Janvier 2024 à 10:00
 Dana est une jeune femme afro-américaine qui se retrouve soudain, à plusieurs reprises dans un court laps de temps, propulsée dans le passé, plus de 150 ans en arrière, dans une plantation esclavagiste. Dana y fait la connaissance de Rufus, le fils du propriétaire de la plantation, dont elle comprend -à sa grande surprise, car Rufus est blanc- qu’il est un de ses ancêtres. Dans ce milieu hostile où elle est prise pour une esclave, Dana va essayer de sauver sa peau mais aussi d’infléchir le caractère de Rufus pour qu’il se comporte de manière moins violente que son père à l’encontre de ses esclaves.
Dana est une jeune femme afro-américaine qui se retrouve soudain, à plusieurs reprises dans un court laps de temps, propulsée dans le passé, plus de 150 ans en arrière, dans une plantation esclavagiste. Dana y fait la connaissance de Rufus, le fils du propriétaire de la plantation, dont elle comprend -à sa grande surprise, car Rufus est blanc- qu’il est un de ses ancêtres. Dans ce milieu hostile où elle est prise pour une esclave, Dana va essayer de sauver sa peau mais aussi d’infléchir le caractère de Rufus pour qu’il se comporte de manière moins violente que son père à l’encontre de ses esclaves.Dans ce roman paru en 1979 Octavia E. Butler nous donne à voir l’esclavage comme de l’intérieur. Les relations entre les esclaves sont étudiées. Du fait de leur plus grande proximité physique avec les maîtres les esclaves de la maison sont parfois considérés comme des collaborateurs par les esclaves des champs dont le travail est beaucoup plus dur. Dana qui parle un anglais châtié, sans accent et sait lire et écrire doit se défendre de ce type d’accusations alors même que ces caractéristiques indisposent grandement les parents de Rufus. L’autrice s’essaie aussi à décrire les sentiments ambivalents entre maître est esclaves. Dana est une femme autonome qui n’a pas l’habitude de se laisser marcher sur les pieds mais, dans le cadre de la plantation, loin de chez elle, témoin et victime de grandes violences, elle constate qu’elle hait Rufus mais qu’en même temps elle lui est attachée. Petit à petit, une part d’elle-même consent à l’esclavage. Elle analyse l’alternance de terreur et de concessions minimes qui empêche les esclaves de se révolter.
Malgré son sujet j’ai trouvé cette lecture plaisante parce que c’est écrit comme un roman d’aventure, avec des rebondissements et de façon vivante, très cinématographique : je pouvais presque visualiser certaines scènes. Kindred (titre original) a d’ailleurs été adapté en série aux Etats-Unis en 2022.
Avec ce roman je découvre Octavia E. Butler (1947-2006) dont j’apprends qu’elle est une référence de l’afro-féminisme américain. Liens de sang est son best-seller. Devenu un classique aux Etats-Unis, il est régulièrement étudié en classes de littérature.
 12 commentaires
12 commentaires
-
Par Anne-yes le 5 Janvier 2024 à 10:00
 La narratrice, Mina, est une femme trans, médecin, originaire du Liban et vivant aux Etats-Unis. A la demande de son amie Emma, trans elle aussi, infirmière qui travaille pour une ONG suédoise d’assistance aux migrants, Mina est venue passer quelques jours sur l’île de Lesbos, en Grèce. Nous sommes fin 2015 alors que des réfugiés, principalement syriens, affluent en masse vers cette île où ils sont parqués dans le camp de Moria. Mina a fait venir de Beyrouth son frère Mazen, seule personne de sa famille avec qui elle est restée en relation après sa transition. Ils font la connaissance de Rachid, secouriste palestinien ; d’une famille de réfugiés syriens dont la mère, Sumaiya, est atteinte d’un cancer au dernier stade et d’un écrivain, l’auteur du roman.
La narratrice, Mina, est une femme trans, médecin, originaire du Liban et vivant aux Etats-Unis. A la demande de son amie Emma, trans elle aussi, infirmière qui travaille pour une ONG suédoise d’assistance aux migrants, Mina est venue passer quelques jours sur l’île de Lesbos, en Grèce. Nous sommes fin 2015 alors que des réfugiés, principalement syriens, affluent en masse vers cette île où ils sont parqués dans le camp de Moria. Mina a fait venir de Beyrouth son frère Mazen, seule personne de sa famille avec qui elle est restée en relation après sa transition. Ils font la connaissance de Rachid, secouriste palestinien ; d’une famille de réfugiés syriens dont la mère, Sumaiya, est atteinte d’un cancer au dernier stade et d’un écrivain, l’auteur du roman.Au bord de la Méditerranée, au contact de gens originaires de la même région qu’elle, Mina retrouve des impressions et des souvenirs de son enfance et de son adolescence. Rabih Alameddine est d’origine libanaise et vit aux Etats-Unis. Il est homosexuel. L’auteur et sa narratrice ont donc beaucoup en commun et le roman inclut des éléments autobiographiques. Sous le regard de Mina Rabih Alameddine se présente comme quelqu’un qui, depuis plusieurs années déjà, s’est intéressé à la question des migrations au Proche-orient et a interrogé des migrants sur leur histoire. Certains de ces parcours sont rapportés dans l’ouvrage, dans des chapitres qui pourraient presque se lire comme des récits indépendants. Ces récits de vie restituent leur individualité et leur humanité à des personnes trop souvent fondues dans l’appellation « migrants ». Difficile de ne pas être touchée. A lire si on se pose des questions sur la nécessité d’accueillir dignement les exilés. Exilé lui-même, l’auteur ressent une vraie empathie pour ces migrants, au point que son séjour à Lesbos le rend malade.
J’ai beaucoup apprécié cet excellent roman avec lequel je découvre Rabih Alameddine. Il est dans mon top 8 de 2023. Je trouve très sympathique le personnage de Mina. Reniée par une mère toxique c’est néanmoins une femme chaleureuse et ouverte, à l’écoute des autres.
L’avis d’Henri.
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Anne-yes le 2 Janvier 2024 à 19:00
Je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour 2024, de bonnes lectures et des moments agréables.
C'est l'occasion pour moi de vous présenter les livres que j'ai le plus aimés en 2023 :
La filière de Philippe Sands
Nager à contre-courant de Özge Samancı
Les femmes aussi sont du voyage de Lucie Azéma
Baba Yaga a pondu un oeuf de Dubravka Ugrešić
La véranda aveugle de Herbjørg Wassmo
Le cercle de Farthing de Jo Walton
Sambre de Alice Géraud
La réfugiée de Rabih Alameddine
Pour Noël j'ai reçu des livres. Il y en a déjà un de lu et un autre bien entamé.
 16 commentaires
16 commentaires
-
Par Anne-yes le 29 Décembre 2023 à 10:36
 Dans ce roman choral trois femmes se battent pour prendre ou reprendre le contrôle sur leur vie. A des milliers de kilomètres les unes des autres, elles sont liées entre elles sans le savoir.
Dans ce roman choral trois femmes se battent pour prendre ou reprendre le contrôle sur leur vie. A des milliers de kilomètres les unes des autres, elles sont liées entre elles sans le savoir.En Inde, Smita est une dalit, une Intouchable. Elle vit dans la misère et dans la crainte des violences des castes supérieures. Elle est pourtant prête à tout pour permettre à sa fille Lalita d’aller à l’école et lui donner un autre destin.
En Italie, Giulia travaille dans la fabrique de postiches de son père. Quand celui-ci se retrouve dans le comas après un accident, elle découvre que l’atelier familial est au bord de la faillite.
Au Canada, Sarah est avocate d’affaire dans un cabinet prestigieux. Elle a entièrement organisé sa vie autour de sa carrière. Après qu’on lui a diagnostiqué un cancer, elle découvre que ce milieu professionnel est impitoyable avec les collaborateurs malades.La narration alterne les histoires des trois personnages dont j’ai vite compris ce qui les liait. L’autrice s’est documentée sur les difficiles conditions de vie des Intouchables et sur la tradition de la cascatura en Sicile. Les chapitres qui concernent Smita sont clairs sur les horreurs qui peuvent encore survenir dans l’Inde rurale.
Le tout est plutôt plaisant, peut-être un peu facile mais c’est clairement un feel good book, c’est donc le genre qui veut ça. L’audiolivre est lu par Estelle Vincent pour le récit de Smita, Rebecca Marder pour celui de Giulia et Laetitia Colombani pour celui de Sarah. Je l’ai écouté sur la route des vacances de fin d’année qu’il a permis de parcourir de façon moins monotone. Il passe sans doute mieux écouté dans ces circonstances que lu. Le chauffeur, qui est un sentimental, l'a beaucoup plus apprécié que moi.
L'avis d'Eva.
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Anne-yes le 26 Décembre 2023 à 19:15
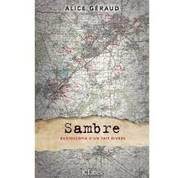 Radioscopie d’un fait divers. Pendant trente ans, dans le val de Sambre, dans le nord de la France, un homme, Dino Scala, a agressé sexuellement ou violé des dizaines de femmes. C’est le plus grand violeur en série de France. Pour présenter cette affaire, la journaliste Alice Géraud a enquêté dans les archives et rencontré des protagonistes, victimes d’abord, policiers, magistrats… Son ouvrage interpelle : comment un criminel a-t-il pu agir impunément pendant autant de temps sur un si petit territoire, comment la parole des femmes victimes de violences sexuelles est-elle entendue ?
Radioscopie d’un fait divers. Pendant trente ans, dans le val de Sambre, dans le nord de la France, un homme, Dino Scala, a agressé sexuellement ou violé des dizaines de femmes. C’est le plus grand violeur en série de France. Pour présenter cette affaire, la journaliste Alice Géraud a enquêté dans les archives et rencontré des protagonistes, victimes d’abord, policiers, magistrats… Son ouvrage interpelle : comment un criminel a-t-il pu agir impunément pendant autant de temps sur un si petit territoire, comment la parole des femmes victimes de violences sexuelles est-elle entendue ?Le premier point s’explique d’abord par la grande misère de la police et de la justice dans une région en crise. Les moyens manquent dès les années 1990. A Aulnoye-Aymeries, le commissariat est installé dans une ancienne villa, l’identité judiciaire dans la salle de bain (un nouveau commissariat vient enfin d’être inauguré en 2023). A Avesnes-sur-Helpe (« sur Help » disent les magistrats), le toit du palais de justice s’est effondré. Les magistrats y sont nommés en début de carrière et ne s’éternisent pas. Le manque de moyens c’est aussi l’absence de relations entre les services. En quelques jours une femme peut porter plainte dans un commissariat, une autre dans la gendarmerie de l’autre côté de la rue, une troisième dans la commune voisine, aucun lien n’est fait. Enfin, hélas, il faut parler des négligences de la police, qui me choquent et qui ouvrent la réponse à la seconde question.
Pendant des années les victimes ont été maltraitées, leur parole mise en doute, leurs agressions minimisées. Pourquoi étiez-vous habillée comme ça ? Que faisiez-vous dehors à cette heure ? Vous êtes sûre que vous avez été violée ? Est-ce que vous avez eu du plaisir ? On voit à l’oeuvre la culture du viol qui imbibe notre société et c’est pour moi le plus dur à supporter dans cette lecture. J’aimerais croire que de telles questions ne seront plus posées. En écrivant ce compte-rendu je lis que notre président a dit que Depardieu rendait « fière la France » et la colère revient. L’autrice montre bien comment les victimes, dont la plupart n’ont reçu aucun soutien psychologique, ont été marquées à vie.
J’ai trouvé cet ouvrage excellent. La quatrième de couverture dit qu’il « change définitivement le regard ». On le souhaite. Attention, cette lecture peut choquer. Non pas tant du fait des descriptions des agressions, l’autrice a évité tout voyeurisme, mais plutôt à cause de la façon dont les victimes ont été traitées ensuite.
Les avis de Sunalee, Ingannmic, Keisha et Kathel.
Sambre c’est aussi une série en six épisodes de Jean-Xavier de Lestrade, diffusée récemment sur France 2. C’est par la série que je suis arrivée au livre. Je l’ai trouvée très bien faite. Chaque épisode est construit autour d’un personnage (la victime, la juge, le commandant…). A la lecture j’ai constaté que certaines avancées qui était parfois présentées comme l’oeuvre d’une seule personne dans la série était en fait beaucoup plus le résultat du travail de fourmi de toute une équipe. La série cependant ne néglige pas les personnage secondaires et est capable de les faire évoluer. Je pense notamment au personnage du policier Jean-Pierre Blanchot. C’était un bon choix de regarder d’abord la série puis de lire le livre car je n’ai pas été gênée par les simplifications que l’adaptation a nécessité. Je les ai repérées à la lecture mais j’en ai aussi vu l’intérêt. Du beau travail.
 6 commentaires
6 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique












