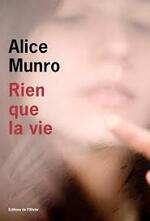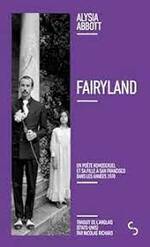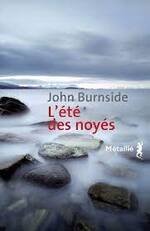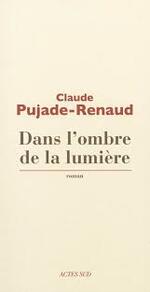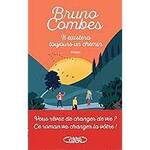-
Par Anne-yes le 25 Juillet 2024 à 15:58
En sortant d’un concert à L’Académie de musique de Prague, Reinhard Heydrich lève la tête et remarque quelque chose qui le choque : « Mendelssohn est sur le toit ! ». En effet, la statue du compositeur d’origine juive est bien là, au milieu de celles d’autres musiciens célèbres. Le protecteur de Bohême-Moravie par intérim ordonne aussitôt qu’on la déboulonne sans tarder. Plus facile à dire qu’à faire…
-
Par Anne-yes le 22 Juillet 2024 à 15:13
La découverte fortuite d’une sépulture de l’aurignacien (il y a 35 000 ans) est l’occasion de nombreuses surprises pour la paléontologue qui l’étudie. Dans une grotte aux murs couverts de peintures de mains aux doigts coupés a été enterrée une femme qui jouissait d’un statut important et qui avait eu plusieurs doigts coupés. Qui était-elle, quelle a été son histoire ?
-
Par Anne-yes le 15 Juillet 2024 à 11:31
L’écrivaine canadienne Alice Munro est morte le 14 mai 2024. Elle était née en 1931 dans l’Ontario. Elle écrivait des nouvelles et a été la première autrice de nouvelles à recevoir le prix Nobel pour son oeuvre, en 2013.
-
Par Anne-yes le 11 Juillet 2024 à 18:17
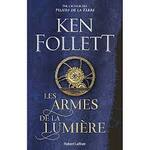 L’action de ce roman se déroule de 1792 à 1824 à Kingsbridge, gros bourg du sud de l’Angleterre où se situait aussi l’action de Le crépuscule et l’aube, Les piliers de la terre, Un monde sans fin et Une colonne de feu. Au tournant des 18° et 19° siècles, les habitants de Kingsbridge voient leurs modes de vie transformés par la Révolution industrielle. L’industrie textile, filage et tissage, se mécanise de plus en plus, entraînant un accroissement des inégalités. Pendant ce temps, en France, c’est la fin de la Révolution puis l’Empire, des événements qui ont des conséquences pour les Britanniques. Elles sont politiques : par crainte d’une contagion révolutionnaire les députés interdisent les syndicats ; économiques avec la crise provoquée par le blocus continental mis en place par Napoléon et militaires quand le pays s’engage dans la coalition contre la France. Il y a alors des enrôlements forcés. Je trouve intéressant d’avoir un regard britannique sur des événements français.
L’action de ce roman se déroule de 1792 à 1824 à Kingsbridge, gros bourg du sud de l’Angleterre où se situait aussi l’action de Le crépuscule et l’aube, Les piliers de la terre, Un monde sans fin et Une colonne de feu. Au tournant des 18° et 19° siècles, les habitants de Kingsbridge voient leurs modes de vie transformés par la Révolution industrielle. L’industrie textile, filage et tissage, se mécanise de plus en plus, entraînant un accroissement des inégalités. Pendant ce temps, en France, c’est la fin de la Révolution puis l’Empire, des événements qui ont des conséquences pour les Britanniques. Elles sont politiques : par crainte d’une contagion révolutionnaire les députés interdisent les syndicats ; économiques avec la crise provoquée par le blocus continental mis en place par Napoléon et militaires quand le pays s’engage dans la coalition contre la France. Il y a alors des enrôlements forcés. Je trouve intéressant d’avoir un regard britannique sur des événements français.
-
Par Anne-yes le 6 Juillet 2024 à 16:10
Un poète homosexuel et sa fille à San Francisco dans les années 1970
Née en 1970, Alysia Abbott est la fille de Steve Abbott, poète et écrivain. La mère d’Alysia meurt quand cette dernière a deux ans. Steve décide alors de vivre ouvertement son homosexualité et s’installe avec sa fille dans le quartier gay de San Francisco. Il est mort du sida en 1992. Dans ce récit à la fois biographique et autobiographique, Alysia Abbott entrecroise le parcours de vie de son père et le sien propre.
-
Par Anne-yes le 27 Juin 2024 à 13:18
L’écrivain écossais john Burnside est mort le 29 mai 2024, il était né en 1955. Il a vécu une enfance défavorisée auprès d’un père mythomane, affabulateur compulsif. Il en a parlé dans Un mensonge sur mon père. Si ce sont essentiellement ses romans qui sont traduits en français, il était aussi poète et a écrit de la non-fiction.
-
Par Anne-yes le 16 Juin 2024 à 11:23
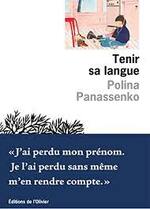 Polina Panassenko est née à Moscou en 1989. En 1993 la famille émigre en France. Quand l’autrice est naturalisée française son prénom est francisé en Pauline. A l’âge adulte elle entreprend des démarches pour retrouver son prénom de naissance. Dans ce récit autobiographique, Polina Panassenko raconte son enfance entre deux cultures, la russe dans le cadre privé et la française à l’extérieur. La petite Polina comprend vite qu’elle a intérêt à séparer les deux : il ne faut pas parler russe à l’école ou avec les camarades de peur d’être moquée ; en Russie où la famille retourne chaque été on l’avertit de ne pas parler français. Elle risquerait d’être kidnappée si cela se savait qu’elle vit en France, lui dit-on.
Polina Panassenko est née à Moscou en 1989. En 1993 la famille émigre en France. Quand l’autrice est naturalisée française son prénom est francisé en Pauline. A l’âge adulte elle entreprend des démarches pour retrouver son prénom de naissance. Dans ce récit autobiographique, Polina Panassenko raconte son enfance entre deux cultures, la russe dans le cadre privé et la française à l’extérieur. La petite Polina comprend vite qu’elle a intérêt à séparer les deux : il ne faut pas parler russe à l’école ou avec les camarades de peur d’être moquée ; en Russie où la famille retourne chaque été on l’avertit de ne pas parler français. Elle risquerait d’être kidnappée si cela se savait qu’elle vit en France, lui dit-on.
-
Par Anne-yes le 13 Juin 2024 à 18:22
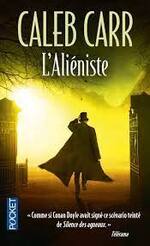 Le romancier et historien militaire américain Caleb Carr est mort le 23 mai 2024, il était né en 1955. Il a grandi dans la crainte que son père, qui le battait, ne le tue. La poète Lucien Carr avait en effet fait de la prison pour homicide involontaire. Le roman le plus connu de Caleb Carr est L’Aliéniste.
Le romancier et historien militaire américain Caleb Carr est mort le 23 mai 2024, il était né en 1955. Il a grandi dans la crainte que son père, qui le battait, ne le tue. La poète Lucien Carr avait en effet fait de la prison pour homicide involontaire. Le roman le plus connu de Caleb Carr est L’Aliéniste.
-
Par Anne-yes le 7 Juin 2024 à 12:01
L’écrivaine Claude Pujade-Renaud est morte le 18 mai 2024, elle était née en 1932. Issue d’une famille bourgeoise, elle refuse la voie qui lui était tracée et s’oriente vers des étude d’éducation physique. Elle a été danseuse et enseignante en sciences de l’éducation.
-
Par Anne-yes le 3 Juin 2024 à 14:05
Le romancier Bruno Combes est mort le 13 avril 2024. Il était né en 1962. Ingénieur chimiste, il publie son premier roman en 2014. Les trois premiers romans ont été publiés en auto-édition puis le succès lui a ouvert les portes de la maison Michel Lafon. Ses romans se classent dans la catégorie feel good et, à l’occasion de sa mort, je découvre à ma bibliothèque un rayon de romans feel good sous la côte RFG.
 Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique